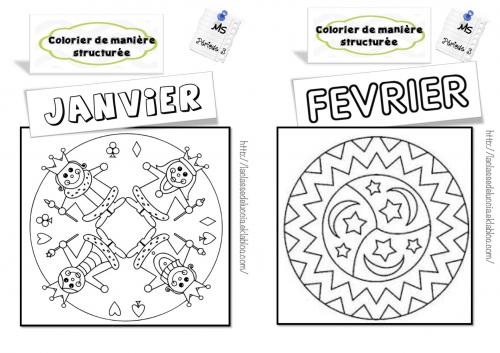Il y a peu, j’ai lu avec attention l’excellent article qu’Alex Mahoudeau a publié en réaction à une petite polémique qui a agité le monde académique britannique, ces deux dernières semaines. Elle a été déclenchée par un billet de la série « Academic Anonymous » du Guardian, consacré à l’injonction de visibilité virtuelle faite aux universitaires. La série « Academic Anonymous », qui est théoriquement un moyen pour le Guardian de permettre aux universitaires de prendre la parole franchement et sans avoir à trop s’inquiéter des conséquences professionnelles de leur exposé, est aussi parfois comprise comme un clickbait de la part du site. The Guardian manque d’ailleurs rarement son objectif et la dernière tribune de la même série, « Student surveys are destroying my confidence, says new academic », a elle aussi fait l’objet d’assez vives discussions. Les articles, très brefs et sans doute lourdement retravaillés par la rédaction du site, ne sont pas faits pour susciter une discussion saine et raisonnable. De façon plus générale, l’activité du Guardian s’inscrit dans le paysage des produits médiatiques adressés aux universitaires, dont les plus connus sont peut-être le Times Higher Education ou bien, de l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, les University Affairs. Dans la même veine que le dernier article des « Academic Anonymous » du Guardian, ces dernières publiaient par exemple, en mai 2016, des vidéos d’enseignants réagissant à leur évaluation par les élèves. On imagine aisément qu’une partie des articles sur ces sites sont produits par des universitaires, trop heureux d’avoir la chance de s’exprimer, sans rémunération particulière.
L’article d’Alex Mahoudeau explore beaucoup des problèmes posés par les réactions hostiles à la tribune du Guardian, à propos des réseaux sociaux. Les analyses que Mahoudeau proposent ne me convainquent pas entièrement mais on ne saurait trop conseiller la lecture de son texte. Il est peut-être regrettable qu’il traite d’abord la polémique pour ainsi dire in abstracto et qu’il n’évoque le contexte particulier de l’université britannique que dans son quatrième point, qui me semble le plus délicat. Il me parait par exemple difficile de négliger que la vivacité des réactions suscitées par le billet d’Academic Anonymous puisse avoir été alimentée par la frustration provoquée par certaines recommandations du Stern Review II, un rapport produit par Nicholas Stern sur le Research Excellence Framework, à ne pas confondre avec le Stern Review on the Economics of Climate Change, du même auteur, en 2006. C’est principalement l’institutionnalisation de « la REF » plutôt que sa portabilité qui a posé problème. En (très) gros, il s’agit de considérer que l’excellence d’une recherche particulière est le produit d’une institution plutôt que d’un chercheur et qu’elle reste attachée à cette institution, sans suivre le chercheur tout au long de sa carrière. On trouvera notamment sur ce sujet quelques explications et un débat, sur le blog d’Adam Goldberg. En tout cas, la non-portabilité a été perçue parfois — mais pas par tout le monde — comme une mesure visant à verrouiller la carrière académique et défavorable à la mobilité sociale. Depuis la publication du Stern Review II, le monde académique britannique me parait réagir plus vivement à toute manifestation d’un vocabulaire d’austérité, qu’il s’agisse d’austérité économique ou de sérieux intellectuel, souvent perçu comme une contrainte exercée sur les marges universitaires. Le paradoxe de la marginalité universitaire, dans ce contexte, a été évoqué par Alex Mahoudeau.
La réponse critique proposée par Alex Mahoudeau tend à occulter encore une large part des réactions du monde académique anglophone, sur Twitter, à l’article premier du Guardian. Il est indéniable que, comme l’écrit ce dernier, une bonne partie de celles-ci fut constituée de « moqueries diverses, de plaisanteries, et d’agressions ad personam » mais elles ont aussi compris des témoignages sur les avantages psychologiques et/ou politiques présumés que pouvaient procurer les médias sociaux. Encore que ces avantages puissent être longuement discutés à leur tour, il me parait qu’un préalable essentiel à cette discussion serait d’écouter ces témoignages pour en bien saisir les implications. Antonio Casilli a tenté de proposer un résumé en français de ces différentes réactions, à partir ce tweet, avec, semble-t-il, le même enthousiasme dont Mahoudeau a bien montré les aspects les plus problématiques.
L’un des apports les plus intéressants du billet de Mahoudeau me paraît être de replacer cette discussion assez complexe dans le contexte des enjeux économiques de l’université contemporaine — on relira notamment le point 1 de l’article, « Cette activité implique de faire réaliser gratuitement par quelqu’un dont ce n’est pas le boulot une tâche importante ». Comme Alex Mahoudeau le souligne, ce travail gratuit, que Casilli aborde de son côté sous le seul angle du digital labor, sans doute en raison de ses propres objets de recherche, est présent de bien des manières dans la vie des universitaires et, s’il est présenté souvent comme un investissement à long terme, d’un point de vue personnel, il est difficile de calculer la rentabilité réelle de cet investissement. L’idée que travailler beaucoup et donc gratuitement — voire en payant son propre travail — procure, à moyen-terme, un emploi est mise en défaut par la rareté de ces emplois. Dans le domaine des études littéraires, la situation est particulièrement claire : je connais d’innombrables collègues qui, tout à fait diplômés, très actifs, avec toute l’expérience et les publications souhaitables, exercent dans l’enseignement secondaire, faute de poste dans le supérieur. L’emploi de ces personnes ne dépend donc nullement de leur intense activité gratuite pour la recherche, qui profite à des centres de recherche, à des éditeurs universitaires et commerciaux, à d’autres organismes académiques et aux collègues déjà en place qui s’y associent, mais de la réussite d’un concours de l’Éducation Nationale. Tout leur travail gratuit a donc été un investissement vain, en tout cas du point de vue de la rémunération professionnelle.
Il n’est pas rare de lire que cette situation est une caractéristique unique de l’université contemporaine, qui serait elle aussi dans une situation remarquable. Cette situation a reçu, je suppose, plusieurs noms mais le plus populaire semble être the neoliberal university. L’expression connait un succès considérable depuis le début des années 2010 mais elle existe au moins depuis l’article bien connu de Slaughter et Rhoades, en 2000, dans le New Labor Forum1. Les conceptions de Slaughter sont marquées par une vision très idéalisée de ce quoi doit être l’université, un espace d’expertise libre et égalitaire où les intellectuels puissent échanger leurs réflexions en toute sécurité, en toute indépendance d’un pouvoir étatique, qui doit cependant le financer. On retrouve cet idéal dans un autre de ses articles, un peu plus de dix ans plus tard :
However, the difficulty of protecting academic freedom under new state forms, such as neoliberalism, should not cause us to abandon it. Rather, we should work to develop new politics and new strategies to reinvigorate the disciplines and professions that were responsible for beginning the struggle for academic freedom at the turn of the twentieth century. The biggest challenge will very likely to be to get members of professions and disciplines — the organizations that began the defense of academic freedom at the turn of the twentieth century — to agree on what they want from the state. Some segments of these professions and disciplines have pushed to expand the neoliberal state and its opportunity structures — for exemple, intellectual property rights, differentiated salaries, reduced teaching loads — while other segments have tried to contain the neoliberal state by mobilizing against it, as did Ignacio Chapela at Berkeley. While disciplines and professions and the professors within them that benefit from the neoliberal state may not intend to constrain academic freedom, embrace of market values may nonetheless have that effect unless we are able to reformulate academic freedom in ways that respond to changing state forms2.
Pour être tout à fait honnête, les raisonnements de Slaughter me paraissent parfois un peu nébuleux, parce qu’il n’est jamais très clair si la liberté académique est une lutte contre le néolibéralisme ou s’il faut au contraire, comme le suggère la fin de la citation précédente, s’adapter à une réalité finalement indépassable. Quoi qu’il en soit, l’université néolibérale est devenue un concept bien répandu dans les discussions sur l’état universitaire contemporain. L’un des aspects de cette discussion, mis en évidence l’utilisation du terme néolibéral, est la tentative assez systématique de définir des caractéristiques propres et nouvelles de l’université néolibérale : injonctions économiques particulières, travail gratuit, exploitations professionnelles, modification des règles de la propriété intellectuelle et ainsi de suite. Pour le moderniste que je suis, ces discussions ne manquent pas de résonner avec les problèmes que posent les pratiques universitaires de l’époque moderne.
En vérité, beaucoup des critiques adressées à l’université néolibérale me paraissent, du point de vue historique, s’appliquer au modèle universitaire occidental en tant que tel — et peut-être à d’autres modèles universitaires mais je serais bien incapable de me prononcer sur la question. Le travail gratuit, par exemple, est un aspect essentiel de la vie universitaire de l’époque moderne et en fait, l’évaluation même de ce qui constitue un travail gratuit ou un travail rémunéré est assez difficile à mener. Il est vrai que cette difficulté n’est pas propre à l’époque moderne, puisque je ne connais pas beaucoup de contrats de travail universitaires qui spécifient très précisément le genre de tâches que l’on entend dans la partie chercheur de la fonction d’enseignant-chercheur. Il me parait difficile d’affirmer de but en blanc que la médiatisation des activités scientifiques, par exemple le live-tweeting, ne fait pas partie des activités de recherche pour lesquelles le chercheur est rémunéré « en bloc » pour ainsi dire et je ne suis pas sûr non plus qu’il soit tout à fait souhaitable d’obtenir une description du travail de recherche divisé en tâches précises auxquelles serait associée une partie de rémunération. C’est seulement en comparant la situation d’un universitaire à un écrivain que l’on peut dire qu’il n’est pas rémunéré pour ses articles. Assurément cependant, les chercheurs qui publient des articles sans avoir un emploi qui cadre leur recherche le font de manière absolument gratuite et aucune espérance de gain futur ne saurait justifier, par un bizarre calcul économique, cette gratuité. Est-ce à dire que le travail de recherche devrait être divisé en gestes et tâches, pour faire l’objet ensuite d’une quantification rémunérative, susceptible de faire l’économie de ces espérances infondées et de proposer une rémunération plus réaliste et immédiate ? Aucune idée.
Ce qui est certain, c’est que pour l’historien, ces questions contemporaines amènent à se poser des questions anciennes et notamment à se demander dans quelle mesure les universitaires de l’époque moderne, par exemple, sont rémunérés pour leurs tâches et dans quelle mesure ils peuvent être amenés à publier avec l’espérance d’un gain futur, c’est-à-dire d’un emploi professoral. C’est un lieu commun, désormais, de l’histoire intellectuelle de l’époque moderne que de souligner que les publications, qui n’apportent pas de rémunération considérable au savant, servent à favoriser une carrière et que cette carrière dépend, plus largement, d’un ensemble de stratégies ou d’habitudes, parmi lesquelles on peut encore compter les pratiques épistolaires, les échanges de livres et d’informations bibliographiques, les voyages, la participation à des polémiques, différentes formes de sociabilité avec la noblesse, l’entretien des relations de parentèle et ainsi de suite. Compte tenu d’une évidente disparité technologique et médiatique, beaucoup de ces pratiques peuvent correspondre à des pratiques contemporaines attribuées à l’université néolibérale.
Mon but n’est pas ici de suggérer qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil même si, à certains égards, il me parait que l’université pré-néolibérale qui servirait de contrepoint à l’évolution actuelle ressemble plutôt à une hypothèse ad hoc qu’à une réalité historique (et pourquoi pas). Le travail gratuit est étroitement lié à l’université dans les deux formes que nous avons évoquées plus haut : celle du travail gratuit qui serait fourni « en plus » par un universitaire par ailleurs rémunéré seulement pour ce qui serait son vrai travail, celui qu’il est légitime qu’il fournisse en échange de son salaire, et celle du travail gratuit consenti par celles et ceux qui veulent devenir des universitaires mais qui se tiennent aux portes, ou parfois beaucoup plus loin que les portes, des institutions du savoir. L’intense activité qui favorise le développement des périodiques savants — et de toutes les formes de périodiques imprimés —, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est souvent une activité gratuite et les intellectuels de l’époque dénoncent déjà l’implication d’une foule d’écrivailleurs qui prétendent à la dignité d’écrivains, de philosophes ou de savants mais qui sont tout juste bons à remplir les pages des publications qui sortent de la presse, dans l’espoir d’être un jour, à leur tour, ou des intellectuels en vue, ou des professeurs d’université.
Une telle situation dépend alors de la conjonction de multiples facteurs, qu’ils soient économiques, technologiques ou organisationnels. Les améliorations notables qui sont apportées à la production de papier, par exemple, notamment avec l’introduction de la vis hollandaise dans le processus de trituration, en réduisant le coût de la matière primaire, permettent l’augmentation de la masse de papier disponible à un investisseur donné et rendent raisonnables les entreprises commerciales périodiques. L’amélioration des réseaux routiers et des postes permet l’exportation plus facile des produits de l’imprimerie, c’est-à-dire à la fois moins coûteuse et plus rapide, ce qui veut dire qu’une nouvelle produite à Paris peut rester nouvelle plus longtemps à Saint-Pétersbourg. L’actualité est ainsi tout autant le produit des pratiques intellectuelles qui visent à la consigner et à la mettre en forme que de l’outillage technologique qui la supporte. Il faut encore ajouter à cela les politiques d’occidentalisation qui se développent, en Europe du nord, en Europe centrale et en Europe de l’est, par exemple au Danemark, en Russie ou en Pologne, et qui reposent en partie sur la formation d’universités et d’académies scientifiques, ce qui entraîne à la fois l’augmentation du nombre d’emplois universitaires (au sens large) disponibles et une nécessité plus pressante de se faire connaître au-delà de son réseau épistolaire restreint.
Quoique l’imbrication de ces phénomènes doit désormais paraître claire à tout historien qui accepte de considérer l’histoire intellectuelle de l’époque moderne non comme la brillante et courageuse épopée qui conduit à l’avénement des Lumières et de la belle tolérance rationaliste mais aussi comme un processus économique et matériel, rien n’est moins évident que d’évaluer la conscience que chaque acteur particulier peut avoir de ce processus et de son implication à l’intérieur de celui-ci. Lorsque tel savant/intellectuel/écrivain/journaliste produit, pour un journal non-officiel, le résumé d’un ouvrage récemment paru, sans toucher une rémunération très significative pour son travail, à quel point calcule-t-il son effort dans l’espoir d’une rémunération future, qui peut prendre la forme d’un emploi universitaire, d’une pension de la noblesse, d’une nomination dans une Académie, d’un préceptorat, etc., et à quel point se contente-t-il de reproduire une pratique textuelle et médiatique désormais si courante qu’elle en est devenue indissociable du statut d’écrivain ? On pourrait dire à certains égards qu’à l’époque moderne, « l’universitaire », « l’écrivain », « le philosophe » ou « l’intellectuel » sont des figures qui se forment en partie par l’accrétion successive d’un certain nombre de tâches, qui dépendent étroitement de structures économiques et médiatiques extérieures.
Une pareille définition présente le sérieux désavantage de nous exposer au même genre de critiques que l’on pourrait formuler à l’égard des arguments sur la rémunération du travail de la recherche ou la liberté académique difficile à cerner de Sheila Slaughter. En effet, si l’on considère que l’intellectuel émerge à partir du moment où on lui attribue (ou bien où il s’attribue lui-même) un ensemble de tâches qui ne dépendent pas vraiment de lui, on suggère que la vie des intellectuels, en tant qu’ils sont des intellectuels, est composée de deux genres d’activités. Le premier genre est celui de tout ce qui est fondamentalement de leur ressort, de tout ce qui constitue la vraie nature de leur travail, de la même manière qu’il existe, apparemment, une vraie nature du travail de recherche, aujourd’hui, pour beaucoup : publier dans des revues à comité de lecture pour être évalué par les pairs, étant entendu, si j’ai bien compris, que cette évaluation est une discussion profitable à l’essor de la pensée. Le deuxième genre est celui de toutes les activités qui se surajoutent à ce noyau fondamental : participer à des salons mondains, entretenir une correspondance avec des Grands (Descartes et Christine de Suède, Diderot et Catherine de Russie), publier dans des journaux savants, participer à des polémiques.
Le problème est évidemment que, plus l’on remonte dans le temps, plus le noyau fondamental, les activités du premier genre, se réduit au profit du second genre. Pour les intellectuels de la seconde partie de l’époque moderne, du long âge classique qui s’étend, pour la France, disons du début de la Fronde à celui de l’Empire3, le noyau imaginaire — imaginaire puisque personne ne vit seulement des activités qu’il implique » correspond au fantasme que l’on nourrit à propos de la République des Lettres humaniste, un fantasme très vivant chez Bayle par exemple. Les humanistes du XVIe auraient joui de la vraie liberté académique, avant qu’un élément perturbateur ne vient tout chambouler. L’identification de cet élément peut varier considérablement d’un écrivain à l’autre : pour Bayle, de toute évidence, ce sont les guerres de religion qui font irruption dans la République des Lettres et l’empêchent de fonctionner correctement mais pour Paul Thomas de Girac, c’est bien plutôt le développement de la mondanité intellectuelle qui signe la mort des authentiques pratiques savantes en les soumettant aux critères d’évaluation exogènes des non-spécialistes.
Mais au XVIe siècle, dans un climat de relative sécularisation d’un certain nombre de pratiques intellectuelles, en plein développement des technologies de l’imprimerie occidentale, sans oublier, justement, les guerres de religion, d’autres auteurs identifient d’autres idéaux et considèrent que l’entretien d’une intense activité épistolaire, absolument nécessaire pour suivre l’actualité bibliographique, est une contrainte nouvelle qui se surajoute à ce qui est essentiel dans l’activité intellectuelle. Montaigne offre un passage très célèbre à ce sujet, dans l’essai-fleuve « De l’expérience », qui clôt le dernier livre de son opus magnum :
Il y a plus affaire à interpreter les interpretations qu’à interpreter les choses, et plus de livres sur les livres que sur un autre subject : nous ne faisons que nous entregloser. Tout fourmille de commentaires ; d’auteurs, il en est grand cherté. Le principal et plus fameux sçavoir de nos siecles, est-ce pas sçavoir entendre les sçavans ? Est-ce pas la fin commune et derniere de tous estudes ? Nos opinions s’entent les unes sur les autres. La premiere sert de tige à la seconde, la seconde à la tierce. Nous eschellons ainsi de degré en degré. Et advient de là que le plus haut monté a souvent plus d’honneur que de mérite ; car il n’est monté que d’un grain sur les espaules du penultime. Combien souvent et sottement à l’avanture ay-je estandu mon livre à parler de soy ? Sottement ; quand ce ne seroit que pour cette raison qu’il me devoit souvenir de ce que je dy des autres qui en font de mesme : que ces œillades si frequentes à leur ouvrage tesmoignent que le cœur leur frissonne de son amour, et les rudoyements mesmes desdaigneus, dequoy ils le battent, que ce nen sont que mignardises et affeterries d’une faveur maternelle, suivant Aristote, à qui et se priser et se mespriser naissent souvent de pareil air d’arrogance.
Ce texte, beaucoup plus complexe que ce que la tradition scolaire a voulu en faire, dans un effort d’intégrer Montaigne à la noble aventure de l’intelligence humaine, est un reflet un peu abstrait des contraintes matérielles fortes et nouvelles qui pèsent sur les intellectuels du début de l’époque moderne, même quand ceux-ci, à l’instar de Montaigne, ne dépendent pas des produits de leur plume pour leur subsistance. Se procurer et commenter des livres de référence toujours plus nombreux et produits dans un espace toujours plus vaste, entretenir un réseau épistolaire avec des intellectuels somme toute très différents de soi-même, sont des exigences qui modifient profondément les pratiques savantes. Un siècle plus tard, cependant, elles sont parfaitement intégrées.
Quant à tirer des conséquences de ces observations rapides sur l’état de cette fameuse université néolibérale, c’est ce à quoi je n’oserais me risquer. Très certainement, les débats contemporains reproduisent une dynamique récurrente qui consiste à intégrer successivement de nouvelles tâches aux noyaux des activités intellectuelles et à considérer que les tâches les plus récentes, qui sont la plupart du temps produites par des injonctions extérieures, sont une contrainte difficile à concilier avec l’exercice véritable que l’on s’est proposé. Il y a peu de temps encore, du point de vue de l’histoire longue de l’université, publier des articles était une nouveauté pénible et difficilement intelligible, alors qu’elle fait désormais assez largement consensus. Est-ce à dire que les réactions virulentes suscitées par la tribune du Guadian illustrent en direct le processus d’intégration des injonctions extérieures les plus récentes, par exemple l’usage des réseaux sociaux, au noyau des activités ? C’est du moins mon opinion.
Ce qui me parait difficile à négliger, en tout cas, c’est que le travail gratuit est indissociable de l’université occidentale (et peut-être de tous les modèles universitaires) et qu’il ne dépend pas de l’université néolibérale. Il n’est pas impossible que celle-ci lui donne des formes nouvelles et particulières qui nécessitent de notre part une grande vigilance et il n’est pas impossible non plus que nos conceptions propres du travail intellectuel comme profession plutôt que comme vocation ou participation à la grandeur culturelle d’un ensemble auquel nous appartiendrions nous invitent à encadrer cette réalité ancienne de manière inédite. Il y a à mon avis un danger conceptuel — si l’on peut dire — à confondre manifestations technologiques nouvelles d’un processus ancien et nouveauté du processus lui-même, puisque cela conduit à n’examiner dans le second que les caractéristiques des premières. Pour le dire autrement, dans le débat sur la profession académique et sa rémunération, les tâches qui la composent et les manières dont elles sont gérées, tel que l’a cadré Alex Mahoudeau, je crois que la question des médias sociaux en tant que technologie spécifique est à peu près accessoire. Elle ne doit pas occulter la réflexion économique, qui est la seule qui soit essentiellement actuelle et qui ne dépend que de manière accessoire de telle ou telle particularité technologique.
- Sheila Slaughter et Gary Rhoades. « The Neo-Liberal University ». New Labor Forum 6 (2000) : 73-79.
- Sheila Slaughter. « Academic Freedom, Professional Autonomy, and the State ». The American Academic Profession. Transformation in Contemporary Higher Education. Sous la direction de Joseph C. Hermanowicz. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2011. 241-273. 266.
- C’est un cadre chronologique polémique que je glisse là, ni vu ni connu, pour voir si les gens vont réagir.