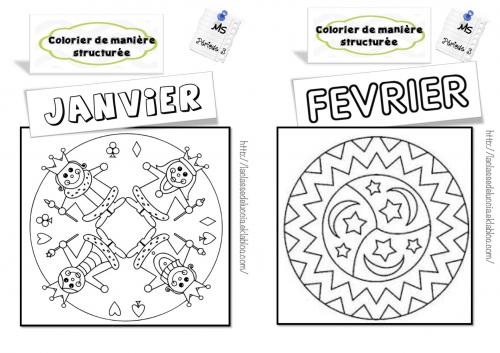J’ai annoncé il y a deux semaines mon projet de donner ici quelques éclairages sur des aspects de ma thèse et je vais aujourd’hui en profiter pour développer un point sur lequel je me contente, dans mon travail doctoral, de faire des remarques rapides. Il s’agit d’un commentaire d’explications données par Philippe-Antoine Merlin dans le Supplément de 1810 à son Recueil alphabétique des questions de droit. En particulier, ce qui m’intéresse, c’est une affaire qui oppose la veuve Duchesne et Lejay, tous les deux libraires, autour de la Henriade de Voltaire, une épopée dont Duchesne avait obtenu le privilège exclusif le 31 août 1770, qu’elle avait fait enregistrer à la chambre syndicale des libraires.
L’affaire en elle-même est assez simple. Le privilège est un instrument juridique et économique qui assure à Duchesne le droit d’imprimer et de distribuer de manière exclusive l’œuvre sur laquelle il porte, pendant une durée déterminée. La chambre syndicale est chargée de consigner les différents privilèges accordés et de tenir le registre qui sert de référence en cas de contestation et les privilèges sont par ailleurs imprimés dans chaque exemplaire de l’œuvre, avec la date d’obtention et la date d’enregistrement. Il n’y a pas de contestation sur la validité du privilège de Duchesne mais sur son extension et, en particulier, sur ce qui constitue un objet intellectuel nouveau.
Lejay, en effet, ne se contente pas d’imprimer la Henriade puisqu’il y ajoute un paratexte critique et qu’il publie l’ensemble sous le titre de Commentaire sur la Henriade par feu M. de la Beaumelle, revu et corrigé par M. Fréron. Le titre peut paraître trompeur, dans la mesure où les volumes contiennent en effet tout le texte de la Henriade et que le commentaire correspond à un système d’annotation, selon la pratique déjà ancienne des commentaires rhétoriques. L’argument de Lejay est qu’il y a là œuvre nouvelle et que la présence du texte même de la Henriade est finalement accessoire, puisque c’est bien du commentaire qu’il s’agit, comme l’atteste son titre. Duchesne ne conteste pas que les deux livres soient distincts mais que le commentaire constitue un changement susceptible de rendre caduque son privilège.
En particulier, Duchesne, qui fait saisir les livres de Lejay par le lieutenant-général de police, accuse celui-ci de contrefaçon, ce dont Lejay se défend en arguant que le contrefaçon consiste à reproduire sans autorisation un texte à l’identique en le faisant passer pour véritable, ce qui ne saurait être son cas, puisqu’il ajoute des commentaires. La qualification de contrefaçon est un problème technique auquel Lejay ajoute un argument culturel, relatif à l’utilité publique : qu’il serait dangereux d’étendre la portée de privilèges de sorte à empêcher la circulation de commentaires profitables à l’édification commune, étant entendu qu’il est peu pratique de commenter une œuvre dont on ne fournirait pas le texte et par conséquent peu souhaitable, à cet égard, d’imprimer le commentaire sans le texte.
Le 6 février 1776, le lieutenant-général de police ordonne finalement la restitution des ouvrages saisis à Lejay et condamne Duchesne à payer les frais de justice. En dehors de l’exposé de l’affaire, la contribution de Merlin se résume à poser une question relative à la contrefaçon, à introduire l’affaire et à poser une autre question, relative elle aux changements juridiques qui interviennent après 1776.
Peut-on poursuivre comme contrefacteur, celui qui ayant commenté un ouvrage, le fait imprimer avec son commentaire ; et le propriétaire du premier peut-il faire saisir le deuxième comme une contrefaçon ?
Cette s’est élevée, sous l’ancien régime, entre la veuve Duchesne et le sieur Lejay, libraires à Paris.
[…] Aurait-on pu juger de même après l’arrêt du conseil du 30 août 1777 ; et pourrait-on encore juger de même aujourd’hui ?
Si Merlin ne donne pas son propre commentaire détaillé de l’affaire, il cite beaucoup plus longuement l’argumentaire de Lejay que celui de Duchesne, réduit en quelques lignes, de sorte que le lecteur n’a guère de doute sur la préférence du juriste en la matière. L’argumentaire de Lejay, appuyé par le jugement final, est bien celui qui vaut et qui propose une analyse raisonnable de la question posée a posteriori par Merlin.
Si ce texte me parait digne d’intérêt, c’est finalement moins pour les détails d’une affaire assez commune et dont la résolution est prévisible que pour la présence de ce précédent dans un ouvrage de droit du début du XIXe siècle. Alors même que Merlin reconnait que l’on a ici affaire à un cas d’« ancien régime », il ne s’en sert pas moins comme référence pour résoudre une question générale susceptible de connaître des applications actuelles et postérieures. En d’autres termes, pour le juriste spécialiste de la jurisprudence, il y a ici une forme de continuité, si ce n’est dans les dispositifs juridiques, tout du moins dans leur esprit et leurs raisons, entre le droit pré-révolutionnaire et le droit post-révolutionnaire.
Pareil commentaire laisse voir que la rupture juridique de la Révolution en matière de droit de la propriété intellectuelle n’a pas été si considérable qu’on a souvent voulu l’écrire et que, de manière générale, l’abolition des privilèges n’implique pas nécessairement un changement juridique radical qui interdit les juristes de dresser des comparaisons entre l’Ancien Régime et les nouveaux dispositifs. Au contraire, il y a bien une continuité dans la réflexion juridique entre les deux périodes, non seulement dans les grands principes de ce qu’il est souhaitable que le droit protège, c’est-à-dire ici l’utilité publique et la propriété privée, mais également dans le détail des jugements et l’application des dispositifs.
Philippe-Antoine Merlin, parfois plus connu sous le nom de Merlin de Douai (1754-1838), n’est pas un juriste de second rang : spécialiste de la jurisprudence dès l’Ancien Régime, il est ensuite membre de l’Assemblée Constituante, où il participe à la liquidation du droit féodal, puis ministre de la justice sous le Directoire, avant de continuer à faire carrière sous l’Empire, où il devient comte. La Restauration lui sourit moins, qui le contraint à l’exil jusqu’en 1830. Il n’a donc rien d’un royaliste convaincu, partisan de l’Ancien Régime, qui tenterait à toute force de restaurer des références datées dans le cadre d’un droit républicain puis impérial. Il représente tout au contraire le souci révolutionnaire d’intégrer le corpus jurisprudentiel à la conception des nouveaux dispositifs, ce qui permet d’instituer une continuité juridique de fait entre l’Ancien et les nouveaux régimes.
La page de titre du Supplément de 1810 ne laisse d’ailleurs pas de doute sur le caractère officiel du projet, puisque Merlin y est présenté en tous ses titres et qualités : « Comte de l’Empire, Conseiller d’Etat, Procureur-Général-Impérial à la Cour de Cassation ; Commandant de la Légion d’honneur et Membre de l’Institut de France ». Les ouvrages de Merlin témoignent non de projets de rupture juridique radicale et de fondation nouvelle pour le droit mais au contraire de la préoccupation de construire une continuité entre les lois de l’Ancien Régime, d’un côté, et les dispositions révolutionnaires, de l’autre, dont le droit impérial, qui prend les unes et les autres pour références, se voudrait une synthèse conciliatrice, justifiée à la fois par son renouvellement positif et rationnel et par ses racines profondes dans les pratiques juridiques bien établies.
La conclusion de l’article du Supplément consacré à la condition de manbournie, c’est-à-dire le cas où un « mari disposait de ses propres à l’effet que sa femme, si elle le survivait, en jouît et fît sa volonté », est à ce titre emblématique. Après un long exposé (529-535) sur le cas de Marie-Anne Flament et Pierre Lechausseteur dans les années 1740, Merlin conclut en citant un arrêt du 14 thermidor an XI, qui repose lui-même entièrement sur le droit de l’Ancien Régime : deux chartes, l’une de 1410 et l’autre de 1533, organisent d’après le droit coutumier la condition de manbournie et servent de référence au rapporteur, Vasse.
Le cas n’a donc rien d’exceptionnel au regard de l’œuvre de Merlin ni, d’ailleurs, des pratiques révolutionnaires : il suffit de consulter la Jurisprudence du Tribunal de Cassation donnée régulièrement par Jean-Baptiste Sirey (1762-1845) à partir de 1802, juriste par ailleurs célèbre pour ses codes annotés, pour se rendre compte que c’est le fonctionnement normal du droit révolutionnaire. Ainsi pour l’an XII, publié chez Laporte à Paris, on remarque par exemple que sur la question de l’anatocisme, il n’y a « aucune loi du nouveau régime, qui ait réformé à cet égard la disposition de l’ordonnance de 1673 » (128). Chez Sirey, la possibilité d’une continuité entre droit d’Ancien Régime et droit révolutionnaire est justifiée par le recours commun des deux régimes au droit romain, comme il l’explique par exemple pour les retraits (42) : « Décidé que les lois nouvelles abolitives du retrait féodal, n’ont pas atteint l’espèce de retrait établi par les lois romaines per diversas et ab anastasio ».
Les différences entre les deux — voire les trois — régimes de droit sont bien sûr considérables mais il convient de garder à l’esprit qu’il existe au moins jusqu’à 1830 un droit partagé entre les deux régimes, à la fois dans de manière théorique et de manière usuelle. Du point de vue de l’histoire littéraire, cette situation permet d’éclairer la capacité des libraires, des imprimeurs et de l’ensemble des agents littéraires à continuer d’opérer dans l’un et l’autre régimes, sans faire nécessairement l’expérience de changements toujours radicaux, à la Révolution, dans la manière de gérer leurs droits de propriété.