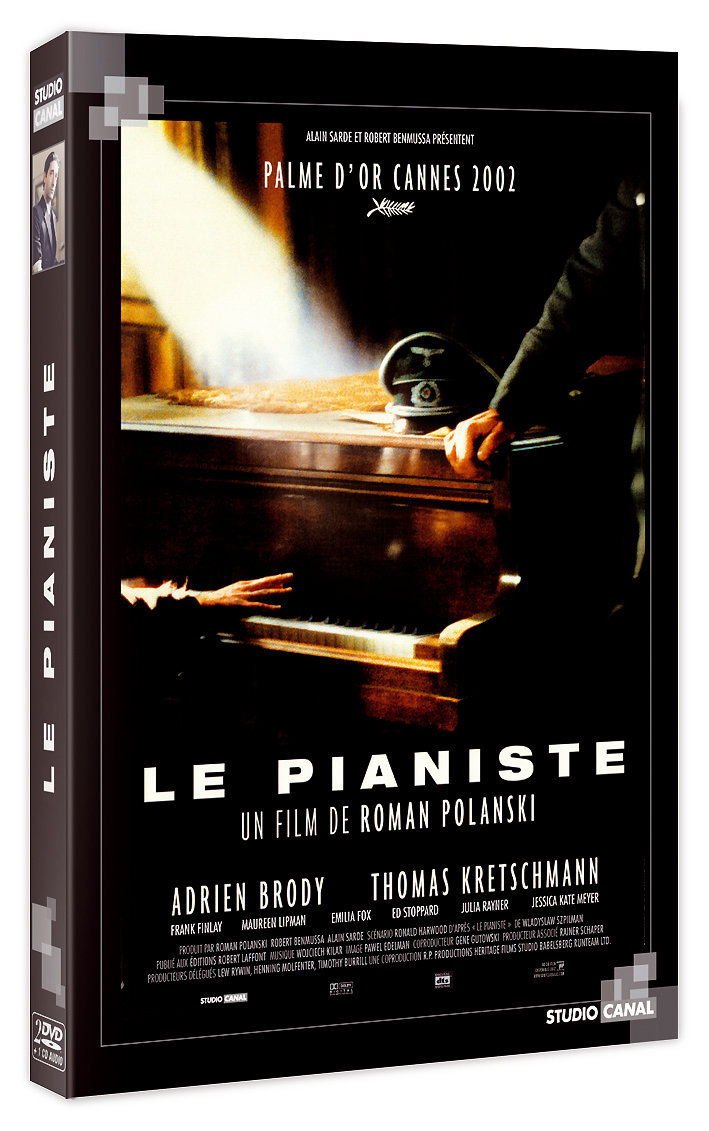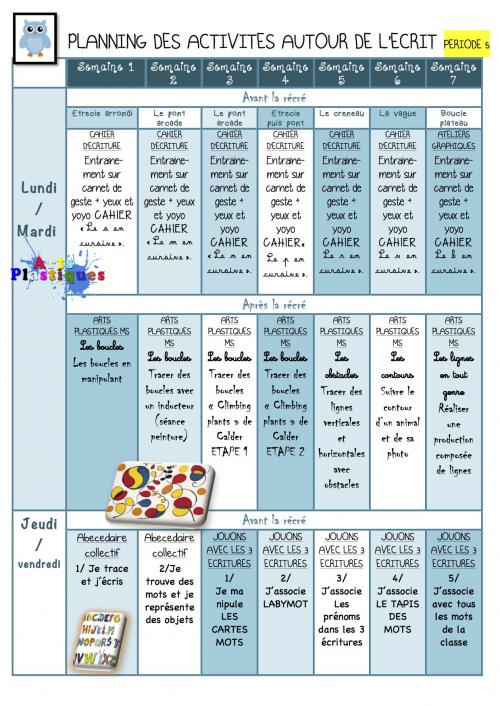Le mois dernier, Cyril Barde publiait sur le carnet de recherche du laboratoire junior GenERe le compte-rendu d’une séance de séminaire intitulé « Comment peut-on être auteure ? » Il y était question du problème récurrent, dans les études littéraires en général et dans celles qui se consacrent à l’étude du genre en particulier, de l’auctorialité féminine et, comme il est fréquent, le texte distinguait un peu implicitement deux grandes périodes : celle de l’Ancien Régime, ou plutôt de l’époque moderne, et celle de l’époque contemporaine, à partir de la fin du dix-huitième siècle. En fait, l’essentiel du texte de Cyril Barde était consacré aux rapports entre les femmes et les activités littéraires dans les deux derniers siècles, laissant de côté les questions spécifiques à l’époque moderne, sauf quelques remarques de passage. Or, force est de constater que la situation des femmes du XVIe au XVIIIe siècles, en France particulièrement mais aussi, quoique d’une manière un peu différente, en Angleterre et en Italie, est loin de refléter la situation des deux siècles suivants.
Il suffit de feuilleter certains manuels d’histoire littéraire, pour les classes ou pour les études, pour comprendre que l’héritage littéraire classicisé par la tradition scolaire ne traite pas de manière équitable la participation des femmes aux activités lettrées en fonction des siècles. Ainsi est-on beaucoup plus susceptible de trouver des noms de femmes pour les époques modernes, avec en tête bien entendu Madame de Lafayette et Madame de Sévigné, avec pourquoi pas Germaine de Staël ou l’une des nombreuses conteuses du XVIIIe siècle, qu’une autrice du siècle suivant. Cent ans plus tard encore, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir ou Annie Ernaux peuvent, selon les manuels, occuper une place à côté d’écrivains masculins. En faisant les comptes, on trouve bien généralement à tous les siècles une disproportion entre les écrivains masculins et les écrivaines féminines, mais les rapports sont loin d’être équivalents d’un siècle à l’autre.
Comme je l’expliquais dans un récent billet, je me suis penché ces dernières années sur la réception féministe de certaines parties de la culture classique issue de l’Ancien Régime et notamment sur celle de La Princesse de Clèves. À vrai dire, les initiatives de la part de la communauté académique sont déjà extrêmement nombreuses. L’année dernière, je signalais par exemple l’existence, au détour d’un billet sur les associations savantes, de l’Aphra Behn Society, qui publie l’ABO : Interactive Journal for Women in the Arts, 1640-1830, mais l’association la plus active est peut-être la Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime. Hasard du calendrier, j’ai appris aujourd’hui l’ouverture du carnet de recherche du projet WEMLO (Women’s Early Modern Letters Online). De la même façon, au-delà de la sphère que nous concevons strictement littéraire, de nombreux projets existent qui se consacrent à des recherches quasi exclusivement féminines : on peut s’en convaincre par exemple en observant la vitalité, parmi d’autres, de la catégorie consacrée à l’ordre carmélite sur le beau carnet Ordensgeschichte. J’aimerais donc compléter ici en amont et à grands traits la question posée par Cyril Barde et le laboratoire GenERe sur la participation des femmes aux activités lettrées, en me concentrant sur les deux dernières siècles de l’époque moderne — et en laissant donc moi-même de côté d’importantes figures médiévales comme Marie de France, Christine de Pisan ou encore Hildegarde de Bingen, sans même parler des autrices de la Renaissance.
Les femmes et la production des textes
La première modalité de participation, celle qui nous est sans doute la plus intuitive, c’est bien sûr la production, par des femmes, de textes littéraires. Cette production est a priori moins importante que celle des hommes, même dans les genres dont on a longtemps pensé qu’ils étaient spécifiquement féminins, comme les romans de la fin du XVIIIe siècle, mais elle n’est certes pas négligeable. Outre les genres de l’intime qui ne connaissent, bien souvent, qu’une impression posthume, quoiqu’ils puissent circuler, et donc connaître une publication manuscrite restreinte, du vivant de l’autrice, comme les textes épistolaires travaillés par WEMLO, à peu près tous les domaines de la littérature offrent une place plus ou moins grande aux autrices, même si — au risque d’employer une formule désormais bien convenue — le genre littéraire dépend du genre identitaire.
Des carrières comme celles de Marie-Catherine Desjardins, qui se fait plus tard appeler Madame de Villedieu, sont devenues typiques, dans l’histoire littéraire, des possibilités socio-scripturales offertes aux autrices sous l’Ancien Régime. Edwige Keller-Rahbé a constitué un site remarquable qui permet de consulter les œuvres de l’autrice ; il suffit d’en parcourir les titres pour comprendre qu’elles se distribuent dans la plupart des genres à la mode, de la nouvelle galante à contexte contemporain au roman d’inspiration antique pseudo-historique, en passant par la tragédie. Contrairement à ce qu’a pu longtemps laisser penser la doxa d’une littérature féminine purement salonnière et donc détachée des réalités de l’imprimerie et du marché de la librairie, les autrices sont d’ailleurs tout à fait capables de calculer les bénéfices à escompter de la vente de telle ou telle œuvre. Catherine Labio a par exemple bien montré, en 1998, dans le Journal of Medieval and Early Modern Studies, comment l’autrice dramatique Aphra Behn avait négocié, en Angleterre, son passage de la scène aux romans, pour profiter de la mode et asseoir des revenus chancelants, un calcul que Lafayette aurait fait elle-même, selon Labio, avec d’autres raisons cependant.
Évidemment, le cas de Lafayette invite à préciser que toutes les autrices d’Ancien Régime ne publient pas pour subvenir à leurs besoins ni, d’ailleurs, ne touchent la moindre rémunération pour le produit de leur travail. À aucun moment la correspondance de Lafayette, qui s’étend par exemple sur des affaires d’héritage ou sur l’achat et la location de biens meubles et immeubles, n’évoque la plus petite partie d’un revenu littéraire. La situation financière de nombreuses autrices restent encore à étudier et elle est d’autant plus complexe à établir que, comme les hommes, quoique en moindre part, certaines tirent des revenus indirects des activités de leur esprit, par des gratifications étatiques ou nobiliaires, en plus ou à la place du produit de la vente de leurs manuscrits. Des autrices comme Madeleine de Scudéry sont par exemple dans cette situation intermédiaire, tandis qu’il est permis de douter que des personnalités à la situation financière beaucoup plus confortable, comme par exemple Germaine de Staël ou Claudine Guérin de Tencin, aient chercher à se rémunérer d’aucune manière par leurs activités scripturales.
Ce caractère parfois accessoire de l’exploitation financière des activités littéraires n’implique en aucune manière que celles-ci ne soient pas tout à fait valorisées, y compris au sein d’un parcours social visant à la promotion. Jean-Luc Chappey, dans un article récemment paru dans le collectif On ne peut pas tout réduire à des stratégies (ma recension), dirigé par Dinah Ribard et Nicolas Schapira, a rappelé que les activités littéraires pouvaient avoir un rôle important et accessoire dans la promotion de carrières extra-littéraires, par exemple dans l’administration post-révolutionnaire. Marguerite de Coüasnon, dans Écrire de soi. Mme de Genlis et Isabelle de Charrière. L’autorité féminine en fictions (ma recension) a montré une semblable interaction entre la production littéraire de Félicité de Genlis et sa situation d’éducatrice dans enfants de la Maison d’Orléans, dans le contexte de l’essor d’une pédagogie rousseauiste. De la même façon, quelques décennies plus tard, à en juger par l’active opposition de Napoléon à la publication du l’ouvrage De l’Allemagne de Germaine de Staël, pourtant autorisé par la censure, les activités scripturales sont aussi étroitement liées aux préoccupations politiques.
Bien sûr, le nombre et la prolixité des autrices sous l’Ancien Régime ne doit pas donner l’illusion que leurs activités étaient toujours admises et qu’elles n’étaient jamais en butte à une réprobation semblable à celles qu’évoque Cyril Barde pour le XIXe siècle. Il est ainsi symptomatique qu’un grand nombre de carrières féminines, même lorsqu’elles sont louées, soient présentées sous le signe de l’exception. Les discours d’admirative perplexité qui entourent les talents uniques d’Isabelle de Charrière (aussi appelée Belle de Zuylen) laissent deviner que le talent intellectuel féminin était loin d’être tenu pour la norme. Plus on pousse dans les domaines de l’érudition, moins la réception des activités féminines parait aisée : la brillante — mais difficile — carrière de la philologue Anne Dacier est un cas peut-être unique et des érudites comme Marie de Gournay, éditrice de Montaigne, sont souvent violemment dépréciées. Si le genre de l’autrice n’est que rarement le seul facteur de son traitement sur le mode de l’exception, positive et négative, par ses contemporains, si, par exemple, les descriptions de l’intelligence précoce d’Isabelle de Charrière relèvent d’un topos des biographies savantes de l’époque, même pour les hommes, et si Marie de Gournay est affligée d’une défaveur qui recouvre plus généralement tout le corpus montaignien au XVIIe siècle, il est tout de même possible d’isoler des traitements spécifiquement genrés.
Certains domaines paraissent ainsi presque entièrement désertés par les autrices, par exemple le droit, l’économie — pourtant en pleine effervescence au XVIIIe — ou encore la théologie. Dans ce dernier cas, certaines responsables d’organisations conventuelles produisent tout de même des textes, mais leur circulation est généralement limitée, ce qui n’a pas empêché Beatriz Polidori Zechlinski, dans sa thèse Três autoras francesas e a cultura escrita no século XVII: gênero e sociabilidades, soutenue en 2012, d’analyser de front les parcours de Marie-Madeleine de Lafayette, Madeleine de Scudéry et Jacqueline Pascal, il est vrai d’abord liée à des pratiques scripturales non-religieuses. On peut se reporter de la même façon aux travaux qu’Agnès Cousson consacre depuis quelques années aux écrits des religieuses de Port-Royal.
Les femmes et l’animation socio-littéraire
La production de textes n’est pas la seule activité que les femmes exercent au sein du monde lettré de l’Ancien Régime. Certaines autrices cumulent par exemple cette fonction avec celle d’animatrice sociale, comme c’est le cas de Madeleine de Scudéry par exemple, ou encore de Louise d’Épinay, notamment à l’intérieur des fameux salons littéraires. Bien sûr, comme le rappelait en 2001 Amalia Marín Martí dans sa thèse Sociedad y literatura en el siglo XVII francés: los salones, les salons littéraires ne sont pas le seul lieu de sociabilité des lettrés et les travaux qu’Alain Viala ou Delphine Denis, parmi d’autres, ont consacré à la galanterie ont bien montré que ce phénomène concurrençait d’autres modes de sociabilité., par exemple celui des Académies. Celles-ci sont encore exclusivement masculines en France, quoique certaines femmes françaises, comme Madeleine de Scudéry ou Anne Dacier, soient admises dans l’Académie padouane des Ricovrati.
Toutes les animatrices littéraires ne sont pas des autrices et toutes ne participent pas à l’animation de la même manière. Certaines, comme Catherine de Rambouillet offrent un espace physique de sociabilité, tandis que d’autres distribuent, de plus loin, des gratifications, voire commandent des ouvrages. Ces dernières activités, qui tiennent tout autant, d’ailleurs, du financement de la production intellectuelle que de son animation sociale, font généralement partie des prérogatives des très grandes aristocrates, voire des cheffes d’État. C’est le cas par exemple de Christine de Suède, qui exerce dans la seconde moitié du XVIIe, une importante activité de mécénat en France, et également, au siècle suivant, de Catherine de Russie, seconde du nom, étroitement liée à Diderot par exemple.
On a souvent présenté les salons littéraires et, plus généralement, les activités de la plume comme un espace de repli pour la grande noblesse de plus en plus privée de ses fonctions politiques par le développement de l’absolutisme royal depuis François Ier, mais en réalité, comme le suggérait en 1995 Barbara de Negroni, en introduction de son ouvrage Lectures interdites : le travail des censeurs au XVIIIe siècle (1723-1774), l’intervention parfois très concrète de certains grands aristocrates dans les affaires de librairie peut être tenue comme une réminiscence de leurs pouvoirs féodaux. L’histoire de la censure est pleine de ces nobles courtisans qui font entrer à Paris ou à Versailles, dans le fond de leurs carrosses que les forces de l’ordre n’oseraient pas fouiller, les volumes des nombreux livres interdits et, en 1734, dans la tourmente de l’affaire des Lettres philosophiques, Voltaire fait agir sur le pouvoir royal certes la salonnière Marie du Deffand mais surtout les duchesses d’Aiguillon et de Richelieu, comme le rappelle Henri-Jean Martin dans Le livre triomphant : 1660-1830 (94-96). De la même manière, l’association de Madeleine de Sablé à Port-Royal, à partir de 1669, ajoute aux protections parlementaires dont bénéficiait déjà le mouvement janséniste.
En d’autres termes, si l’histoire littéraire, dans son versant le plus littéraro-littéraire, a accordé une place considérable à l’activité salonnière des femmes, il convient de ne pas négliger par ailleurs leur poids politique et financier dans les processus de production et de circulation des textes — ou de non-circulation, dans le cas de la censure. Encore une fois, tous ces rôles ne sont pas spécifiquement féminins : si la tenue d’un salon littéraire est bien, a priori, une activité de femme, l’entregent politique peut tout aussi bien être une qualité masculine. Non que les salons littéraires soient complètement dépolitisés du reste : celui de Claudine Guérin de Tencin, étroitement liée au cardinal Dubois, ministre d’État de Philippe d’Orléans, fut par exemple un haut lieu d’activités politiques.
Les femmes et la production des livres
La production matérielle des objets livres est le dernier domaine des activités scripturales de l’Ancien Régime auquel les femmes ont pu participer. À vrai dire, les modalités de cette participation sont encore assez mal connues. On sait qu’une veuve d’artisan pouvait hériter de son commerce à la mort de son époux et continuer à le gérer. Que de nombreuses veuves choisissent alors de se remarier n’est pas nécessairement une indication supplémentaire du régime patriarcal auquel elles sont par ailleurs évidemment soumises, dans la mesure où les mariages et remariages, souvent signés entre artisans de la même industrie, sont l’occasion d’une mise en commun de ressources financières et matérielles, constituant par exemple un moyen de s’approprier fontes, privilèges ou plaques de gravure. Le cas le plus célèbre d’une veuve exerçant activement la profession de libraire, après le décès de son mari, est certainement celui, dans la seconde moitié du XVIIIe, de la veuve Duchesne. On reconnaissait à celle-ci de toute évidence les compétences juridiques et commerciales nécessaires au développement et à la protection de son activité de libraire, puisqu’elle est encore citée en 1810, par exemple, par Philippe-Antoine Merlin, politicien et juriste du tournant du siècle, dans un Supplément au recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux, sorte d’addendum à un manuel de jurisprudence, qui évoque le cas d’un procès ayant opposé, le 31 août 1770, Duchesne à un concurrent parisien, Lejay, à propos d’une édition contrefaite de la Henriade.
C’est toujours leur situation à l’intérieur du système patriarcal qui permet à d’autres femmes d’exercer par intermittence des fonctions importantes dans certaines entreprises de librairie. C’est le cas d’Élisabeth Bertrand, qui à partir de 1779 assure depuis Neuchâtel, les relations commerciales de la Société Typographique de Neuchâtel, en tenant la volumineuse correspondance de celle-ci avec des imprimeurs, des libraires et des auteurs de toute l’Europe, pendant les déplacements en France, et notamment à Paris et à Lyon, des deux dirigeants de la STN d’alors, Ostervald et Bosset. Or, Élisabeth Bertrand est non seulement la veuve de Jean-Élie Bertrand, qui vient de mourir, mais aussi la fille de Frédéric Samuel Ostervald : c’est par cette double qualification patriarcale qu’elle est autorisée à prendre une part active dans la gestion de la STN à la mort de son époux. Cette situation d’évidente minorité ne l’empêche pas d’avoir parfois un pouvoir décisionnaire assez important, en l’absence d’Ostervald et Bosset. Hélas, l’histoire du livre s’est pour l’heure peu intéressée à de semblables participations féminines et il est ainsi symptomatique que L’Aventure de l’Encyclopédie de Robert Darnton fasse une place à Jean-Élie Bertrand dans son index, mais aucune à Élisabeth, alors même qu’il cite les lettres de celle-ci par ailleurs.
Quant à la participation éventuelle des femmes aux étapes les plus physiques de la fabrication du livre puis de sa commercialisation, elle demeure sans aucun doute la plus difficile à documenter. Les tâches d’impression, de la composition à la presse, étaient vraisemblablement toutes réservées aux hommes, compagnons imprimeurs ou apprentis, qui menaient une existante itinérante et souvent célibataire, en attendant de pouvoir s’établir un jour à leur compte comme maître-imprimeur, pourquoi pas en devenant le gendre d’un maître déjà en place — un rêve qui devient de plus en plus inaccessible au fil des décennies. Des femmes sont cependant orésentes à différentes étapes du processus de fabrication. Alix Chevallier, dans un chapitre consacré à la fabrication du papier au XVIIIe, dans le second volume de l’Histoire de l’édition française dirigée par Martin et Chartier, signale la présence de quatre femmes dans la fabrique de Langlée en 1790, « dont deux aux chiffons et deux à la colle et au séchage » (40). Il est possible également que des femmes aient voyagé avec les compagnons imprimeurs et gravité autour des ateliers d’imprimerie. On peut espérer que de nouveaux travaux d’archives permettent de mieux cerner, à l’avenir, les contours de leur participation à la production matérielle du livre.
***
Il y a trois ans, dans l’introduction de l’ouvrage collectif Les femmes dans la critique et l’histoire littéraire (ma recension), qu’elle dirigeait chez Honoré Champion, Martine Reid déplorait l’invisibilité supposée de celles-ci dans les travaux contemporains. En fait, cette invisibilité est largement exagérée, mais elle est devenue un lieu commun des études de genre, comme une justification rituelle aux effets pervers. À la lire, on croirait que la seule nécessité de restituer une exactitude historique à notre compréhension des activités littéraires aux siècles antérieures justifierait l’étude systématique de la participation des femmes à ces activités, comme si cette participation n’avait justement pas d’autre intérêt que celui d’être minoritaire et minorée. Du reste, l’argument portait d’autant moins que l’ouvrage, du reste d’un grand intérêt, trouvait sa place dans la très traditionnelle maison Honoré Champion, au sein d’une collection fraîchement inaugurée Littérature et Genre, et avait été tiré d’un colloque organisé à la Bibliothèque Nationale de France en 2009 — on peut difficilement faire plus institué.
Ce dont souffre l’histoire littéraire des femmes, ou bien l’histoire des femmes en littérature, ou (encore mieux) l’histoire de la participation des femmes aux activités culturelles scripturales, ce n’est pas tant d’un déficit de reconnaissance de l’autrice, de la possibilité pour une femme d’être productrice d’une œuvre littéraire, mais bien plutôt de la sacralisation de cette œuvre littéraire, qui invite à reproduire une histoire littéraire bis et à construire un panthéon de substitution propre à héroïser quelques figures bien choisies, féministes avant l’heure, comme Lafayette ou, plus encore, Mary Wollstonecraft, championne toute catégorie de l’hagiographie proto-féministe. J’avais déjà formulé ces critiques un peu vives, l’année dernière, dans ma recension d’un ouvrage de Geneviève Guilpain, Les Célibataires, des femmes singulières : le célibat féminin en France (XVIIe-XXIe siècles), qui avait donné lieu à une brève controverse avec l’autrice, avant que nous n’adoptions réciproquement le sage parti d’un silence diplomatique.
Le souci de promouvoir des modèles féminins ne devrait à aucun moment s’accompagner d’une entreprise, même involontaire, de masquage des conditions socio-économiques de leurs activités. L’intérêt de l’article de Catherine Labio, cité plus haut, sur les activités de romancières de Behn et Lafayette réside par exemple dans sa volonté de décrire l’angle commercial qui influe sur les choix littéraires des autrices, en fonction de la réception qu’elles anticipent pour leurs ouvrages, plutôt que de céder à l’exaltation d’une intuition désincarnée, géniale et courageuse, s’élevant avec une précocité révolutionnaire parfaitement improbable contre l’ordre patriarcal dont les autrices, les veuves libraires ou les chiffonnières sont tout à la fois les produits, les victimes et les agents. Le danger pour les études de genre de produire une seconde histoire culturelle aristocratique, romantique et littéraire est d’autant plus considérable que les outils de cette histoire sont précisément ceux contre lesquels les études de genre ont vocation à s’élever.
Illustration : Plaque commémorative en l’honneur de Mary Wollstonecraft, The Polygon, St Pancras, Londres.