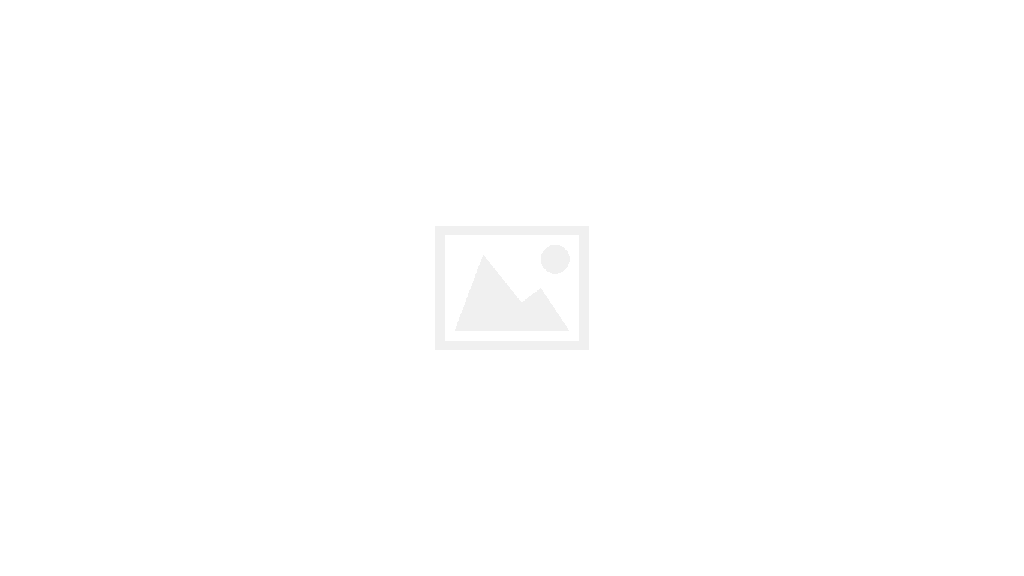Aujourd’hui, je voudrais développer avec vous l’une des notes de bas de page de ma thèse. Je viens de finir une section de chapitre consacrée au Journal des Sçavans, qui est désormais peut-être le périodique français le plus célèbre de l’époque moderne, et j’ai croisé au cours de mon travail un cas d’étude bibliographique qui, à mon avis, peut permettre de comprendre certaines difficultés qui se posent dans ce domaine depuis longtemps. Pour ma part, je travaille sur le Journal dans le cadre d’une étude sur les pratiques bibliographiques de l’époque moderne, entre 1645 et 1777, en relation avec l’usage de la figure d’auteur comme outil d’interprétation et de classification. Dans cette partie centrale de ma thèse, je me penche sur des documents de trois types surtout : le Dictionnaire de Bayle, les recueils d’ana et les recensions d’ouvrages dans les périodiques. Ce n’est toutefois pas la question de l’auteur qui va nous occuper ici mais plutôt celle de la fiabilité de ces documents et du genre de démarche critique qu’il faut adopter quand on les manipule.
Le problème a été assez bien décrit, au début des années 2000, par Francine Wild, à propos du genre du recueil d’ana1 . Ces recueils d’anecdotes, dont j’avais parlé ici en 2013, sont consacrés la plupart du temps à une figure centrale d’érudit ou de littérateur. À partir du milieu du XIXe siècle, ils sont couramment utilisés par les savants comme des sources documentaire sur la vie des auteurs de l’époque moderne. Il est assez rare que cette source soit soumise à une critique serrée, alors même que la constitution de ces recueils, l’authenticité des anecdotes et les raisons qui poussent à la publication sont loin d’être évidentes. Francine Wild a bien montré qu’il était nécessaire de s’intéresser à ces genres en tant que tels, non seulement parce qu’ils sont une production importante de l’époque moderne mais aussi parce qu’ils comptent parmi nos sources historiques. Heureusement, depuis quelques années, les études sur la littérature anecdotique se développent avec beaucoup de vivacité et l’on peut attendre des résultats précieux de ces recherches.
Des objets comme le Dictionnaire historique et critique ou le Journal des Sçavans sont dans une situation assez semblable. D’une certaine façon, on pourrait dire qu’ils souffrent d’un excès de familiarité. S’ils ne font pas forcément partie des classiques de la littérature scolaire et s’ils concernent plutôt les spécialsites, ces documents sont assez célèbres pour qu’on soit tenté de supposer que l’examen en a été mené de manière approfondie et que tous les aspects de la question ont été élucidés. En fait, en littérature moderne, et je suppose dans beaucoup d’autres domaines, on peut rencontrer ce paradoxe qui veut que plus un document est fameux, moins il a de chance d’être scrupuleusement étudié. Je me souviens par exemple qu’il y a des années, quand je commençais mon premier mémoire de master et que je débarquais à l’université, après trois ans de classes préparatoires, avec l’envie de travailler sur la Princesse de Clèves, mon directeur présumé m’avait expliqué que tout avait été écrit sur la question et qu’il n’y avait probablement pas grand-chose à trouver. En fait, si.
Le Journal des Sçavans sous sa forme moderne (c’est-à-dire ancienne — c’est logique) est une publication périodique qui parait au rythme de plusieurs numéros par an entre 1665 et 1792 et qui survit, d’une autre manière, jusqu’à nos jours. Cette seule description fait bien voir combien il est illusoire de croire que l’on puisse facilement épuiser les difficultés posées par un semblable document ou ensemble de documents. On peut lire l’excellente notice que lui consacrée Jean-Pierre Vittu dans le Dictionnaire des journaux 1600-1789 désormais disponible en ligne pour voir que malgré d’amples informations, celle-ci n’aborde encore que les conditions de publication et l’évolution matérielle du journal, sans rentrer en profondeur dans la question de son contenu. La bibliographie critique donnée par Vittu dans la notice n’est plus à jour hélas mais les travaux récents qui font mention du Journal des Sçavans s’en servent plutôt comme d’une source documentaire que comme objet d’études. Jean-Pierre Vittu, qui a fait sa thèse sur le Journal, a cependant produit d’excellents articles sur celui-ci, qui ont paru… dans le Journal des savants et que l’on peut consulter en ligne. Ces articles offrent un remarquable panorama de la publication sur le temps long de l’époque moderne mais ne proposent pas, à proprement parler, d’analyse textuelle ou qualitative d’échantillons du document.
Il faut dire qu’aujourd’hui, il y a plusieurs manières de faire de la bibliographie, parce qu’il y a plusieurs méthodes et plusieurs usages. Certaines recherches bibliographiques se déroulent à l’intérieur d’une discipline bibliographique qui a ses propres objectifs et ses propres critères de validation. D’autres sont menées par des commissaires-priseurs, par exemple, qui sont chargés d’évaluer puis de vendre des manuscrits ou des ouvrages anciens et qui cherchent par conséquent à en déterminer l’authenticité puis la rareté. D’autres encore sont produites par des historiens ou des littéraires, comme moi, qui, quoique ne disposant pas de formation bibliographique en bonne et due forme, sont amenés à résoudre, souvent, comme on va le voir, avec les moyens du bord, des problèmes ponctuels qui se posent à eux dans le domaine. De manière plus générale, on peut dire qu’il y a deux grandes oppositions dans les méthodes bibliographiques. (Attention, je fais passer ici en contrebande un peu de ma propre terminologie.)
Bibliographie matérielle vs. Bibliographie critique : La bibliographie matérielle, qui est parfois un adjuvant de la bibliophilie amateure ou commerciale, consiste en la description des caractéristiques physiques du livre et peut recouvrir aussi les processus de fabrication voire de commercialisation. La bibliographie critique va, de son côté, proposer une interprétation du contenu du livre et une évaluation de son importance.
Bibliographique quantitative vs. Bibliographique qualitative : La bibliographie quantitative étudie un nombre aussi grand que possible de documents du même type (par exemple tous les numéros du Journal des Sçavans), avec en vue une exhaustivité théorique, afin de dégager les normes de ce type et de construire des catégories opérantes pour l’avenir. La bibliographie qualitative s’engage, elle, dans la description complexe et interprétative d’un document en particulier, généralement pour dégager les multiples manières dont il entre en relations avec d’autres éléments culturels.
Comme on peut l’imaginer, la bibliographie matérielle quantitative est en quelque sorte plus confortable parce qu’elle a l’air plus scientifique : non seulement elle est capable de produire des catégories, des classes, des ordres mais elle fournit aussi des chiffres, des courbes d’évaluation, des mesures. La bibliographie critique qualitative, à l’inverse, est toujours suspectée de privilégier à la fois le particulier du document et le subjectif de l’analyste aux dépends d’une connaissance générale et fiable des documents. Elle n’en reste pas moins essentielle à celles et ceux qui s’occupent de la valorisation des documents, que cette valorisation soit commerciale pour les commissaires-priseurs ou patrimoniale, pour les archivistes, les commissaires d’exposition, les bibliothèques.
Comme on l’aura deviné, j’estime que le Journal des Sçavans est en manque cruel d’études bibliographiques critiques et qualitatives, qui dépassent hélas le cadre de mes maigres compétences en la matière. Pour qu’on ne croie pas qu’il s’agit là d’une lubie toute personnelle, j’attire votre attention sur les Lyell Lectures de 2015. Comme les lecteurs spécialisés le savent peut-être, le Centre for the Study of the Book, une importante institution basée aux Bodleian Libraries de l’Université d’Oxford, organise chaque deux séries de conférences sur la bibliographie, les Lyell Lectures, du nom du célèbre bibliographe James Lyell, et les McKenzie Lectures, du nom du non moins célèbre professeur de bibliographie Donald McKenzie. En 2015, ce premier cycle de conférences a été donné par le Jésuite — il y tient — Michael Suarez. Tous les enregistrements sont librement accessibles en ligne. On me pardonnera j’espère de ne pas lésiner mais, à mon humble avis, ces conférences de Suarez sont l’une des plus remarquables contributions des dix dernières années à l’étude des conditions de la production intellectuelle à l’époque moderne et, plus généralement, une réflexion essentielle (et dynamique) sur la manière de faire l’histoire des phénomènes culturels. Bref, c’est génial. Si j’insiste, c’est parce que le sujet de chaque conférence est un peu austère et susceptible de rebuter certains auditeurs. Quoi qu’il en soit, Michael Suarez y propose une défense et illustration de la bibliographie critique et qualitative en se concentrant à chaque fois sur un document particulier.
Nous avons donc affaire ici à un problème très actuel (enfin, du point de vue académique, évidemment). Ce que je propose, c’est de nous consacrer ici à la recension faite par le Journal des Sçavans d’une traduction en français de l’Odyssée par Guillaume Dubois de Rochefort. L’article parait en juillet 1777 et on peut le lire, bien entendu, dans sa version numérisée par la Bibliothèque Nationale de France. L’intérêt que je porte à cette recension tient à sa position extrême dans la période que j’étudie, en 1777, et par la place qu’y tiennent la figure du Traducteur et le nom de l’auteur. Elle présente un problème mineur du point de vue bibliographique, qui ne porte pas à conséquence pour mon propre travail, mais que nous allons observer ici.
La recension, qui ouvre le numéro de juillet 1777, même si, plus tard, dans le volume des numéros rassemblés de l’année, elle se trouve à la page 451, fait plusieurs pages et comporte des commentaires sur le rôle et les moyens d’un traducteur, d’une part, et de larges extraits de l’Odyssée traduite, d’autre part. De ce point de vue, elle ne présente rien d’étonnant. En effet, le Journal des Sçavans de l’époque moderne parle souvent de littérature, en particulier quand les œuvres littéraires ont une dimension historique : on y recense le Parallèle des Anciens et des Modernes de Perrault, des contes de La Fontaine qui puisent dans le fonds commun de la culture classique ou les différentes traductions des œuvres antiques. Il faut bien comprendre qu’à l’époque, le contenu du Journal des Sçavans est très, très divers. Si l’on se reporte à la table des matières du numéro précédent, de juin 1777 donc, quelques pages avant notre recension, on trouve des Idylles de Théocrite, des Nouvelles Expériences sur la résistance des fluides, un Exposé des moyens curatifs & préservatifs qui peuvent être employés contre les maladies pestilentielles des bêtes à cornes ou encore des Contes mis en vers. De la même façon, dans notre numéro de juillet, à côté de la poésie homérique se trouvent une Histoire de l’Eglise & des Evêques de Strasbourg, depuis la fondation de l’Evêché jusqu’à nos jours ou le Recueil des Pièces qui ont remporté les Prix de l’Académie des Sciences, depuis leur fondation en 1720.
L’annonce de la parution de cette Odyssée et les remarques que fait à son sujet le journaliste s’inscrivent dans une réflexion plus large entamée, dans les pages du Journal des Sçavans, au gré des recensions, sur la question de la traduction du grec ancien, qui fit l’objet, on le sait, de vif débat au XVIIIe siècle. Dans le Journal, le débat devient un thème récurrent à partir des années 1750 quand de nouvelles traductions des textes homériques ou de nouvelles éditions de traductions déjà anciennes ravivent ce qu’il est convenu d’appeler la Querelle d’Homère, qui avait opposé à partir de 1714 Antoine Houdar de La Motte et Anne Dacier, lorsque celui-ci avait tourné en vers français, sans connaître le grec ancien, la traduction de l’Iliade de celle-là. La querelle impliqua beaucoup d’autres acteurs et donna lieu à un ensemble de textes théoriques et polémiques dont il serait trop long de rendre compte ici. En tout cas, la traduction d’Anne Dacier demeure une référence pour tout le XVIIIe siècle.
En 1764 cependant parait la nouvelle traduction de l’Iliade par Paul-Jérémie Bitaubé, un pasteur francophone de Koenigsberg. Or, la recension qu’en donne le numéro de mai 1765 du Journal des Sçavans place immédiatement cette traduction nouvelle dans le contexte de la Querelle d’Homère, à peu près éteinte cependant depuis la mort d’Anne Dacier en 1720. La recension propose une discussion assez longue, pour un texte de ce genre, des différents points de vue développés pendant la Querelle d’Homère et du style adopté par les savants et les polémistes pour les faire valoir. À partir de cette date, lorsque le Journal évoque une édition d’un texte antique, il propose très souvent une recension de la traduction et de ses particularités plutôt que du contenu du texte lui-même. C’est le cas par exemple de la recension consacrée aux Pensées de Marc-Aurèle en août 1770 ou, en août 1783, des quelques lignes sur un nouvel Homère.
Le texte de la recension consacrée à Dubois de Rochefort est donc à tous égards conforme d’une part à la diversité des sujets abordés par le Journal et d’autre part à la volonté manifeste de celui-ci, depuis les années 1750, de mettre en évidence un débat de fond sur les traductions antiques en général et homériques en particulier. La personnalité de Dubois de Rochefort n’a apparemment pas beaucoup passionné les chercheurs contemporains mais on peut tout de même dire que c’est une figure bien identifiée de l’hellénisme français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, notamment pour son Discours sur l’objet et l’art de la tragédie grecque et ses Observations sur les difficultés qui se rencontrent dans la traduction des poètes tragiques grecs. Bref, nous avons affaire à une recension typique d’un traducteur bien installé dans le paysage littéraire.
Où est, alors, le problème ? Tout au début, dans l’intitulé de la recension, dont je donne ici l’image.
Formellement, l’intitulé est conforme à ce que l’on trouve dans le Journal depuis la fin des années 1660. Comme je l’explique dans ma thèse, après une brève période de maturation dans les premiers numéros, la mise en forme des recensions se stabilise très rapidement et témoigne d’un souci limité mais bien réel de fournir toutes les informations pertinentes sur l’objet matériel que les lecteurs sont susceptibles d’acquérir. Le titre de la recension offre un ensemble d’informations bibliographiques sur l’ouvrage recensé, dont la précision peut malgré tout varier considérablement, puisque certains intitulés décrivent le format de l’ouvrage, le nombre de pages, la présence ou non de tables, tandis que d’autres se contentent de donner le titre, parfois abrégé comme ici, le nom de l’auteur et l’adresse, c’est-à-dire la ville, le nom de l’imprimeur et, parfois, la rue dans laquelle celui-ci réside et l’enseigne de sa boutique. La recension peut par ailleurs proposer des titres intermédiaires, quand l’ouvrage est composite, par exemple quand il s’agit d’un recueil de plusieurs œuvres. Dans ce cas, l’usage rapidement adopté est que le titre de l’ouvrage physique est indiqué en capitales sur la première ligne tandis que les titres des œuvres que cet ouvrage contient sont simplement en italique.
Le problème posé par le titre de la recension n’est donc pas d’ordre formel et typographique et il ne réside pas non plus dans la relative imprécision bibliographique (l’absence de format ou du nombre des pages). En réalité, cette imprécision est justifiée par le fait que la recension de juillet constitue un second extrait, c’est-à-dire qu’une première recension a déjà été publiée. Il faut donc remonter dans les numéros précédents, jusqu’à mai 1777, pour identifier la première recension de la même œuvre. Voici le titre de cette première recension.
On constate qu’il donne des informations plus précises, notamment le nombre de volumes mais aussi le format de l’ouvrage, mais on constate surtout qu’il donne une adresse différente. En mai 1777, on apprend en effet que l’ouvrage est publié « À Paris, chez Brunet, Libraire » et en juillet 1777, qu’il est « chez M. Lambert, Imprimeur, rue de la Harpe ». Et c’est à partir de là que tout dérape !
Qui a édité, si l’on veut employer un terme contemporain, la traduction de Dubois de Rochefort ? Lambert ou Brunet ? Lambert et Brunet ? Ni Lambert ni Brunet ? Est-ce qu’on nous ment ? Si oui, pourquoi ? Avons-nous affaire à une erreur ? Si oui, comment s’est-elle produite ? Distraction ? Faute professionnelle ? Complot ? L’affaire est bizarre. Bizarre, bizarre et d’autant plus bizarre qu’à première vue, c’est ce que nous allons appeler l’adresse Lambert qui est fausse, plutôt que l’adresse Brunet. En effet, si l’un est libraire et l’autre imprimeur, comme le suggère le Journal alors, selon la division des fonctions dans le processus éditorial qui se met en place au XVIIIe siècle, c’est chez le premier plutôt que le second que l’on est susceptible d’acheter un ouvrage. Si en effet les fonctions de librairie (qui vend les livres mais aussi met en branle le processus éditorial) et d’imprimeur (qui produit matériellement les feuilles des livres et éventuellement les assemble) sont conjointes au début de l’époque moderne, rapidement le travail se divise et cette division est formalisée par le Code de la Librairie au début du XVIIIe siècle. Il faut observer cependant que certains libraires peuvent rester imprimeurs et inversement, dans une certaine mesure et dans des circonstances particulières, de sorte qu’il n’est pas absolument exclu que Lambert soit à la fois imprimeur et commerçant de librairie. Si l’on suppose l’adresse Lambert fausse, une question se pose cependant : pourquoi est-elle plus précise que l’adresse Brunet ? En effet, l’adresse Lambert précise la rue tandis que l’adresse Brunet ne donne que la ville.
Ce qui parait le plus important d’abord, c’est d’établir la bonne adresse. Pour cela, il suffit de se tourner vers les éditions en vente de la traduction de Dubois de Rochefort et les numérisations qu’on en propose pour appâter le client. On trouve par exemple cette fiche qui donne l’adresse Brunet et surtout la numérisation de la page de titre où cette adresse apparait de la manière suivante « A PARIS, chez BRUNET, Libraire, rue des Écrivains ». Comme le format, le nombre de volumes, la date et le titre complet correspondent aux informations données dans la recension I, il n’y a pas de raison apparente de douter de la concordance. On peut même consulter le premier volume de l’ouvrage en entier, ce qui n’est pas suffisant évidemment pour juger du format mais permet de se livrer à l’opération suivante, qui consiste bien sûr à bondir de la page de titre à la dernière page imprimée, où l’on voit, effectivement, la mention « De l’Imprimerie de Michel Lambert, rue de la Harpe, près Saint Côme, 1777 ». À partir de là, la situation parait claire : dans sa première recension, le journaliste a recopié la page de titre et dans la seconde recension, il a recopié l’adresse finale. Ce qui… est quelque peu incohérent, malgré tout. Pourquoi ne pas avoir recopié fidèlement les informations de la première recension ? Quel sens pratique y aurait-il, dans la rédaction de la deuxième recension, à recopier la page de titre partiellement, ignorer la suite et recopier l’adresse d’impression tout à la fin ? Le contenu de la recension lui-même ne permet pas vraiment de répondre à cette question ; tout juste peut-on remarquer que les citations qu’en fait le journaliste sont apparemment toutes tirées du premier des deux volumes qui composent l’ouvrage, puisqu’aucune n’est postérieure au VIIe livre et que le second tome commence au livre XIII.
La réponse se trouve peut-être dans un autre ouvrage, les Pensées diverses contre le systême des matérialistes, A l’occasion d’un Ecrit intitulé: Systême de la Nature, que l’on trouve en ligne. Cet ouvrage, que l’on attribue à Dubois de Rochefort et qui est une réponse à Holbach, parait en 1771 avec l’adresse « Chez LAMBERT, Imprimeur-Libraire, rue de la Harpe, près Saint-Cosme ». Je n’ai pas trouvé de recension de ces Pensées dans les numéros de 1771 et 1772 du Journal mais il m’est possible qu’elle m’ait échappé. En tout cas, Dubois de Rochefort est un habitué de l’imprimerie Lambert et l’imprimeur est aussi libraire. Reste à savoir si le journaliste est assez familier de Lambert pour lui attribuer spontanément un ouvrage, par erreur, faute de vérification. En mai 1772, une recension de la traduction des Odes pythiques de Pindare par Michel de Chabanon me parait apporter une pièce décisive à notre enquête. En effet, le dernier paragraphe de cette recension est le suivant :
L’exécution Typographique de cet Ouvrage mérite aussi des Eloges. Le Texte est placé à côté de la Traduction. Les caractères Grecs sont de la plus grande beauté, aussi bien que les caractères François. Cet Ouvrage & plusieurs autres sortis depuis peu des presses de Lambert font honneur à cet Imprimeur.
Michel Lambert ne commence pas à exercer à cette époque, puisqu’il est connu par exemple pour son édition du Père de famille de Diderot, mais le journaliste identifie bien, à partir du début des années 1770, un tournant dans la qualité des impressions et en particulier des impressions grecques, qui fait de Lambert, en tant que tel, un sujet digne d’intérêt2 . En revanche, Brunet, qui par ailleurs est le libraire de l’Académie Française jusqu’à sa mort au début des années 1780, ne fait l’objet, à ma connaissance, d’aucun commentaire du même genre.
On peut alors suggérer deux interprétations de la recension de juillet 1777.
Valoriser le texte : Le journaliste a volontairement mis en avant la part prise par Lambert dans la production de la traduction de Dubois de Rochefort, parce qu’il a déjà fait, dans les pages de son journal, l’éloge des qualités techniques des ouvrages produits par Lambert. C’est donc une manière supplémentaire de mettre en valeur le livre recensé. Il est possible, même, de reconstituer alors un discours sous-jacent qui court depuis les années 1750 dans les pages du Journal des Sçavans : grâce à la combinaison de nouveaux efforts de traduction et de nouveaux efforts d’impression, on aurait dépassé les apories de la Querelle d’Homère des années 1710 et 1720 pour trouver un équilibre dans l’édition et la traduction des ouvrages en grec ancien, un équilibre dont la traduction de Dubois de Rochefort serait un nouvel exemple.
Effet de familiarité : Le journaliste a intitulé sa recension sans examiner de nouveau l’ouvrage, dont il avait le premier tome ouvert devant lui pour tirer des citations, et il a donné l’adresse dont il s’est souvenu, celle de Lambert plutôt que celle de Brunet, parce qu’il a été plus marqué, dans le passé, par le travail de Lambert en matière d’impression grecque que par celui de Brunet. L’erreur est alors un effet de sa familiarité avec le travail d’un imprimeur en particulier et avec la question traductologique en général.
Reste un problème qu’il est à mon avis plutôt difficile de résoudre et qui relève de toute façon de la bibliographie matérielle : avons-nous effectivement affaire à une erreur ? De fait, l’Odyssée de Dubois de Rochefort est bien le travail combiné de Brunet et de Lambert, dont les adresses sont présentes respectivement au début et à la fin de chacun des deux volumes. S’il est d’usage de donner l’adresse principale, qui est celle du libraire en début de volume, il n’est pas en soi incorrect que Lambert ait participé à la publication de cette Odyssée. Au-delà du débat théorique de savoir ce qui constitue ou non une erreur bibliographique, la question est toute pratique. Le rôle d’une adresse, avant même de servir à l’identification correcte de volumes, est de savoir à qui il faut s’adresser, justement, pour se procurer l’ouvrage. Un lecteur de 1777, qui se rendrait rue de la Harpe, chez Michel Lambert, peut-il ressortir avec une Odyssée ? Autrement dit, quelle est la nature du contrat qui lie Lambert et Brunet (voire Dubois de Rochefort lui-même) pour l’impression de cet ouvrage ? Il n’est pas rare qu’un imprimeur, particulièrement s’il exerce aussi comme libraire, puisse recevoir/garder quelques volumes pour les vendre, même s’il n’est pas le libraire principal. Je n’ai hélas pas de documents pour répondre à cette question mais il n’est pas exclu qu’ils existent quelque part dans des archives parisiennes.
*
J’espère avoir donné ici un aperçu rapide du genre de bénéfices que l’on peut espérer tirer d’une enquête bibliographique qualitative qui se concentre sur un petit phénomène textuel — une incohérence dans les adresses — plutôt que sur un très large corpus de documents. Ces quelques mots qui changent entre mai et juillet 1777 dans la recension de l’Odyssée de Guillaume Dubois de Rochefort prennent du sens dans le contexte plus large de la Querelle d’Homère, de la manière dont le Journal des Sçavans la traite avec quelques décennies de distance mais nous donnent aussi à comprendre le genre d’attention qu’un journaliste peut porter à la traduction d’une part et à la production matérielle des ouvrages en langue ancienne d’autre part. Ils nous invitent à nous interroger sur la réputation dont jouissent les libraires et sur les effets qu’elle peut avoir dans la représentation bibliographique et savante des ouvrages qui sortent de leurs presses mais aussi sur le genre de contrats qui peut unir deux libraires dans un même projet.
Comme l’explique plusieurs fois Suarez dans les Lyell Lectures, une semblable attention au détail d’un document voire d’une séquence micro-textuelle n’implique en aucune manière que l’on cherche à se débarrasser de l’analyse de corpus larges. On a vu du reste au cours de cette enquête que l’élucidation de notre problème minuscule conduit à manipuler des textes de plusieurs milliers pages, à travers différents ouvrages et plusieurs années du Journal. On aurait même pu continuer en parlant des erreurs qui concernent Dubois de Rochefort dans la France littéraire de Joseph-Marie Quérard, en 1836, qui mentionne une édition fantôme de l’Odyssée en 1776 et ne traite pas toutes les adresses des autres livres du traducteur avec une diligence égale. Les démarches de la bibliographie quantitative et de qualitative tout comme les démarches de la bibliographie matérielle et critique sont complémentaires et poreuses.
Évidemment, on peut citer les deux recensions du Journal sans relever ce problème d’adresse et sans, cependant, que cela prête à conséquence, pas même pour l’identification de l’ouvrage, pour lequel seul le titre complet est vraiment nécessaire, puisqu’il est facilement disponible sur Internet. Il n’empêche que cette donnée qui a l’air purement factuelle, purement descriptive, l’adresse d’un ouvrage, même quand elle est exacte en un sens, n’est pas indifférente et est au contraire chargée de sens. En d’autres termes, si l’attention bibliographique n’est pas nécessaire pour tous les travaux et ne saurait constituer une exigence systématique raisonnable, elle n’en est pas moins tout à fait profitable.
On pourrait tirer alors des conclusions plus générales sur la place qu’occupe aujourd’hui l’attention bibliographique dans les recherches en littérature et en histoire culturelle mais je crains d’épuiser la patience des lectrices et des lecteurs. Nous reviendrons peut-être sur ce problème en une autre occasion.
- Francine WILD. Naissance du genre des Ana (1574-1712). Paris : Champion, 2001. On peut trouver une recension en ligne de cet ouvrage par Guy Demerson dans le Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance.
- Selon Paul Dupont, Michel Lambert est reçu imprimeur en 1758. Paul DUPONT. Notice historique sur l’Imprimerie. Paris : Paul Dupont, 1849.